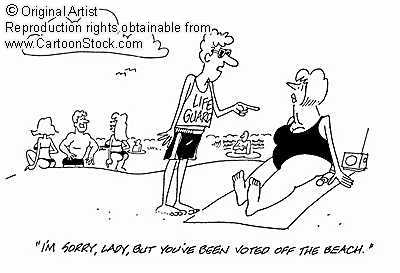La transformation
Dans cette partie, nous allons analyser comment la
télévision peut transformer la réalité.
La surmédiatisation et la
surinformation se remarquent principalement dans les journaux télévisés. En
effet le poids des mots ne valant pas le choc des images, les gens s’informent
plus facilement en regardant les journaux télévisés qu’en lisant. Visant à
faire un maximum d’audience, les directeurs de chaînes favorisent la
retransmission en direct, car cela réduit le temps de l’analyse et de la
réflexion. De ce fait, le téléspectateur garde une distance par rapport à
l’évènement mais est assez proche pour se sentir concerné et culpabiliser.
Celui-ci croit alors qu’il a compris grâce à la richesse visuelle. Peu à peu
s’établit donc dans les esprits l’idée que l’importance des événements est
proportionnelle à leur richesse en images. Plus un reportage sera riche en
images plus il sera regardé. De ce fait les chaînes utilisent la
spectacularisation (la recherche du sensationnel à tout prix), la mise en scène
et l’émotionnel.
Nous pouvons développer l’exemple de la guerre du
Golf, en effet elle a été la première
guerre télévisée et a donc influencé beaucoup de spectateurs par le choc des images qui ont
été parfois utilisées de façon excessive. En effet, certaines chaînes sont
allées jusqu’à mettre en scène des faux témoignages, pour émouvoir les
téléspectateurs, afin de populariser la guerre. Cela définit l’expression de
« l’information spectacle ». Encore maintenant, le journal télévisé
est structuré comme une fiction, c'est-à-dire que dans chacun d’eux, les nouvelles se succèdent mais ne sont
présentées que rapidement, sans être traitées en profondeur : trop de
nouvelles, donc surinformation, avec trop peu de temps consacré à chacune
d’elle entraîne la désinformation.
Les chaînes de télévision se servent donc de beaucoup
d’images sensationnelles au détriment de l’information qui se doit d’être
objective afin d’augmenter l’audimat. Ils livrent lors de journaux télévisés, lorsqu’ils
traitent de sujets importants, un nombre largement excessif d’images pour faire croire a une
information complète. Comme un dirigeant de TF1, a dit, il s’agit moins
d’informer que de répondre aux attentes du public, de rejoindre l’opinion
majoritaire, et donc faire l’audience la plus large possible. En exagérant
certains faits, ils donnent une dimension importante à des événements qui ne le
sont pas autant et vice versa. Pour prendre un exemple plus récent, nous
pouvons citer l’exemple de la crise des banlieues durant laquelle s’était posé la question de savoir s’il fallait ou
non médiatiser cet événement car certains émeutiers étaient violents juste
devant les caméras : faut-il ou non médiatiser la violence.
Cela nous amène à nous intéresser à la violence à la
télévision.
On peut s’apercevoir que de nos jours la violence est
de plus en plus présente à la télévision. Cette forte présence a des nombreux effets négatifs.
Ce graphique nous montre ce que pensent les personnes
que l’on a interrogées du niveau de violence à la télévision.

Nous allons analyser deux principaux effets qui sont
la banalisation de la violence ainsi que le désir de reproduction de la
violence vue à la télévision.
La violence à la télévision se trouve dans la plupart
des programmes on trouve même des dessins animés violents comme la série
« Happy Tree Friends »
qui met en scène des personnages enfantins qui cependant font preuve d’une
violence extrême entre eux ( sang; torture….). Cette série est un parfait
exemple du fait que la violence touche tous les publics à la télévision et en
particulier un public de plus en plus jeune.


La violence touche les plus
jeunes
Happy
Tree Friends
De plus au cours de notre enquête nous avons pu voir
que le plupart des gens trouvaient les journaux télévisés trop violents. Il est
vrai que les journaux télévisés n’hésitent pas à traité des sujets en montrant
des images violentes qui peuvent être vues par tout le monde. En Novembre 2006
par exemple les journaux télévisés de TF1, France 2, et France 3 ont consacré
environ 15 minutes au sujet de l’Irak qui est souvent traité par des images
violentes (Attentats, scènes de guerres..).
Mais la banalisation de la violence se fait le plus
souvent par le biais des films et téléfilms. Les plus touchés par cette
banalisation sont les enfants et les adolescents car pour eux la violence ne
choque plus, elle peut devenir un jeu ou certains jeunes peuvent penser que
comme dans les films la violence peut résoudre tous les conflits ou s’intègre
dans la société.
Cette banalisation peut entraîner un désir de
reproduction de cette violence vue à la télévision. Mais ce fait n’est pas
nouveau. Déjà au Etats-Unis dans les années 20, on avait établi une relation
entre la fréquentation des salles de cinéma et la délinquance. De nos jours
cette relation existe encore mais elle s’effectue plus par le biais de la
télévision que par le cinéma. Par exemple en 2002 un jeune de 17 ans frappe de
plusieurs coups de couteau une de ses camarades, il expliquera ensuite qu’il a
eu cette envie de tuer après avoir vu plusieurs fois le film Scream. Ceci est un fait grave, mais certains
reproduisent la violence vue dans certaines émissions comme Jackass qui
montre un groupe de personnes qui font tout et n’importe quoi sans se soucier
des conséquences.

Johnny Knoxville
(Jackass)
Il n’y a pas que les adolescents qui sont touchés par
cette banalisation car une enquête sur des enfants de 6 à 10 ans montre la
corrélation entre le nombre d’heure passées devant la télévision (films
d’actions et séries télévisées) et les comportements agressifs ou délinquants.
Nous allons maintenant voir quelle est la relation
entre la politique et la télévision.
Les hommes politiques, depuis l’arrivée de la
télévision, ont toujours voulu s’en servir. Le premier grand homme politique
qui l’a utilisée fut le général De Gaulle, il avait très bien compris l’impact
de ce nouveau média et a profité de son essor pour en faire un outil de
communication du pouvoir.

Charles De Gaulle
Avant que la télévision ne soit séparée de sa tutelle
de l’état, le gouvernement pouvait montrer ce qu’il voulait et ne laisser pas
s’exprimer l’opposition. La télévision sert aussi aux hommes politiques pour
passer des messages importants, maintenant, les grands discours présidentiels
sont toujours télévisés.
De
nos jours on peut se demander si les hommes
politiques font plus attention à leur image (notamment à
la télévision) qu’à
leur propos. Par exemple Nicolas Sarkozy, durant ses meetings engage
une
société privée pour le filmer et c’est
lui-même qui choisit comment il va
apparaître à l’écran car c’est la
société que l’homme politique a choisi qui a
les droits de l’image de ce dernier. Ainsi les chaînes de
télévision ne peuvent
pas choisir les images qu’elles vont diffuser car elles leur sont
imposées par
la société privée choisie par l’homme
politique.
Un autre aspect important de la politique à la
télévision est les débats. Au cours de notre enquête, 56.19% de personnes nous
ont répondus qu’ils regardaient les débats télévisés mais seulement 36.27% nous
affirment que ces débats peuvent modifier leur opinion politique. Ces débats
peuvent aussi participer à la démocratisation de la politique car tout le monde
peut les regarder et ainsi connaître réellement les idées des candidats.
La télévision est un moyen de « contrôle »
de la population et les hommes politiques le savent bien et s’en servent. Par
exemple, certains journalistes ont dénoncé le fait que les journaux télévisés
ont surmédiatisé la violence lors de la campagne présidentielle de 2002, ce qui
« avantage » les partis de droite.
Dans son rôle de transformation du réel, la télévision peut être un facteur de socialisation des individus.
Les
médias sont omniprésents dans la vie quotidienne,
et en particulier la télévision, qui est le principal
média chez les jeunes.
L’enfance est la période d’apprentissage et de
découvertes, celle ou l’enfant
expérimente de nouvelles choses en s’appuyant sur la
réalité, ce qu’il voit
autour de lui, mais notamment de ce qu’il voit à la
télévision. Plus il passe
de temps à la regarder, plus il en retire des informations et
des idées, et
c’est à l’âge de 7 ans qu’il se rend
compte de réalité ou non de la télévision,
ce qui ne veut pas dire qu’il les distingue pour autant. Environ
un an plus
tard, c’est l’âge où l’enfant devient le
plus exposé au pouvoir de la
télévision, car il est en âge de se forger sa
propre opinion. Elle joue donc un
rôle important dans la socialisation des plus jeunes, pour qui
les écrans sont
devenus des objets routiniers, simples et ludiques.
La télévision peut parfois être vue
comme un élément du lien familial, du fait qu’elle est généralement regardée
collectivement. De plus, nous pouvons voir qu’une fille sur deux regarde son
émission favorite avec sa mère. Ce lien entre parents et enfants est en
revanche quasi inexistant pour d’autres médias, et en particulier pour les
« médias numériques », c'est-à-dire les ordinateurs, les consoles de
jeux vidéo…
Par ailleurs, la télévision peut être
un moyen d’échanges, au sein de la famille, ou d’un groupe. D’après une étude
menée par Dominique Pasquier, directeur de recherche au CNRS, 8 enfants sur 10
disent parler de la télévision avec leurs amis, à l’école. Le petit écran est
largement en tête des sujets de discussions abordés dans la famille, et peut
même aller jusqu’à devenir une source de conflits entre les enfants et leurs
parents, du fait que ces derniers veulent contrôler et parfois imposer les
programmes que leurs enfants regardent, ce qui leur donne le sentiment de
continuer à exercer leur autorité.
Le graphique ci-dessous nous montre pour quelles
personnes, la télévision est un sujet de discussion :
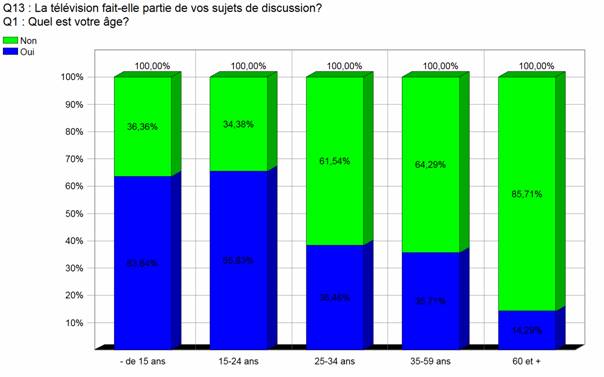
La télévision a
un impact plus important sur les familles d’origines modestes, que sur les
familles plus aisées, du fait que la télévision est presque l’unique source de
distractions, d’information, et d’ouverture sur le monde, tandis que chez les
familles favorisées, d’autres facteurs enrichissent leurs débats et leurs
échanges. A cela on peut ajouter que dans certaines familles, la télévision a
un rôle très important dans l’organisation des horaires (comme les repas) ou la
disposition des meubles.
La socialisation peut également se
faire par le biais de la télé-réalité, car nombreux sont les jeunes qui
s’identifient aux candidats.
La première émission de télé-réalité a été diffusée en
1973 aux Etats-Unis, elle s’appelait « An American
Family » et racontait le divorce d’une famille
californienne. Le principe de ce genre d’émissions est donc de s’introduire
dans la vie privée de personnes ordinaires. Suite au développement de ces
programmes, d’autres ont connu leur essor, comme par exemple les reality shows, des émissions dans lesquelles Monsieur Tout
Le Monde vient raconter une expérience qu’il a vécue.
Le succès de la télé-réalité explose
véritablement en 1999 avec l’émission « Big Brother » diffusée au Pays-Bas. L’idée : enfermer
plusieurs candidats dans une villa sous l’œil de caméras et montrer comment ils
cohabitent. L’émission remporte un tel succès qu’elle s’exporte dans 70 pays,
dont
Il y a 5 genres dans la
télé-réalité :
-le télé-crochet :
des candidats sont en compétition pour gagner la possibilité de devenir des
professionnels de la chanson.
-l’expérience de vie : des
candidats échangent leurs vies, et vivent dans un milieu totalement différent.
-la séduction : des
candidats doivent séduire d’autres participants venus en couple.
-l’isolement : des
candidats sont isolés du reste du monde, et sont éliminés un par un, jusqu’à ce
qu’il ne reste que le gagnant. Ces derniers se trouvent soit dans une villa
luxueuse, soit sur une île déserte.
-l’intervention d’un
expert : grâce à des experts, des candidats peuvent changer leur mode de
vie, leur apparence, la décoration de leur maison...
Sur ce graphique nous pouvons voir que
les femmes regardent plus souvent la téléréalité que les hommes. Nous pensons
que ce type de programmes fait appel aux valeurs féminines et aussi que les
hommes regardent plus les programmes sportifs pour se détendre.
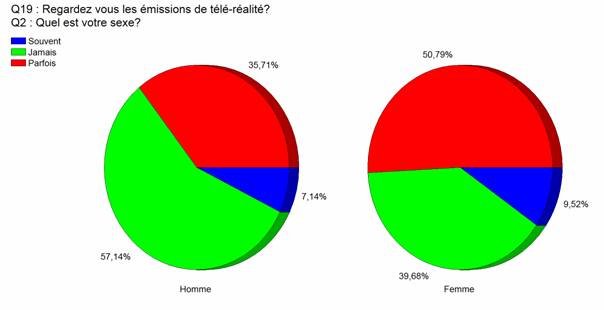
Pour attirer des
téléspectateurs blasés, des émissions de plus en plus dégradantes sont
apparues. Dans « Koh Lanta », on a vu des
candidats déguster des vers blancs et dans « La ferme des
célébrités », la chanteuse Eve Angeli aspergée
de bouse en trayant une vache.
Ces émissions ne sont donc
principalement qu’exagération, et mise en scène, dans le but de choquer et de
se différencier, pour attirer de plus en plus de téléspectateurs.
Cependant, l’institut Médiamétrie
réalise des études montrant que les séries auraient davantage de succès que les
émissions de télé-réalité, car les gens se disent lassés des débordements. De
la à dire que la « real TV » est enterrée serait un terme trop fort,
nous nous contenterons de citer Mathias Gurtler, qui
travaille dans cet institut, et qui soumet «que nous sommes simplement à la fin
d’un cycle ».
Nous pouvons donc en déduire que la télé-réalité est
un moyen pour faire passer des valeurs comme l’individualisme mais son but
principal est de réaliser de l’audience.